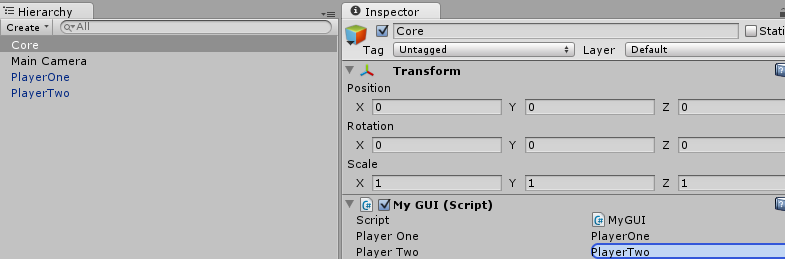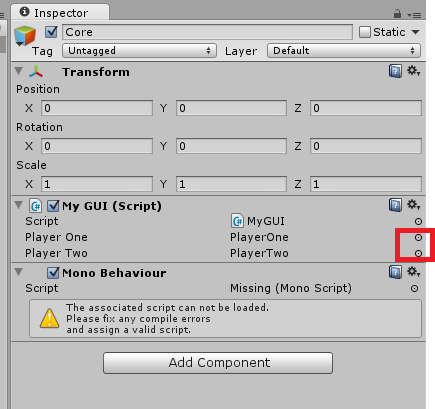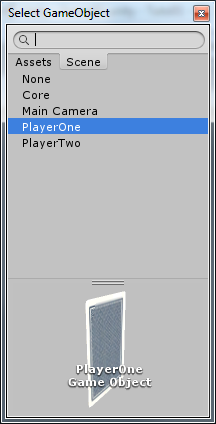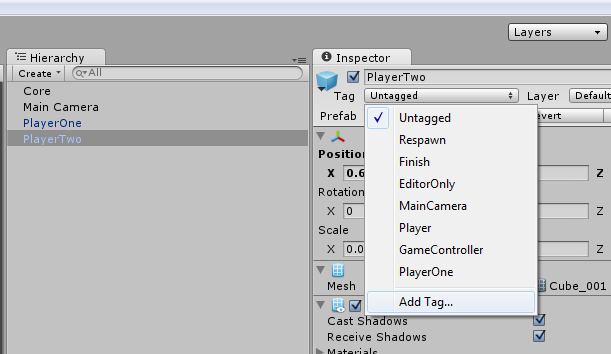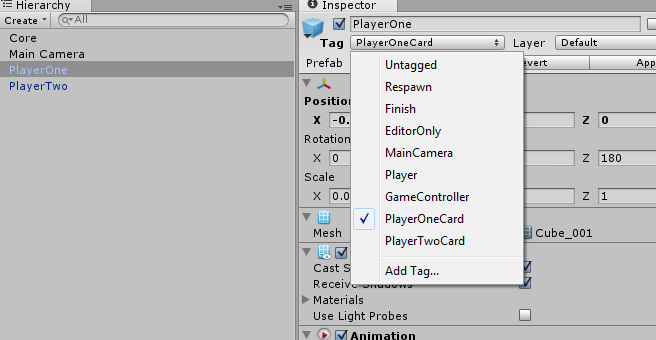Introduction
La critique du néolibéralisme est aujourd’hui un lieu commun : la droite condamne ses « excès » (« l’ultralibéralisme »), la gauche, même modérée, le rejette. En dehors du discours politicien, le terme est repris un peu partout comme objet d’analyse : en science politique, dans les médias, et même sur ce site [1] ; sans que soit, souvent, prise la peine de le définir. Souvent, le terme est péjoratif : il serait l’équivalent d’un « fondamentalisme de marché », voir un « extrémisme du libre-échange », en tous les cas une version radicale du libéralisme bien éloignée des théories d’Adam Smith ou de Locke. Ce « néo-libéralisme », dit-on souvent, serait né dans la société du Mont Pèlerin, une organisation de libéraux assez discrets, et, porté notamment par Friedrich Hayek et Milton Friedman, serait devenue l’idéologie dominante chez les dirigeants occidentaux dans les années 80, les politiques de Margaret Thatcher et Ronald Reagan en étant une bonne illustration. L’utilisation du terme semble donc faire consensus… Mais se heurte à deux obstacles : en premier lieu, les libéraux eux-mêmes le rejettent, au point que Pascal Salin, un libéral de premier plan en France et ancien président de la Société du Mont Pèlerin, en est venu à rédiger un article signifiant que non, « le néolibéralisme ça n’existe pas ! » [2] . On pourrait supposer qu’il s’agisse là d’une réticence des libéraux contemporains à revendiquer pareille appellation, tant elle est critiquée. D’autant qu’on peut dénier faire partie de quelque chose, et y appartenir malgré tout. Toutefois, un second problème existe : la signification de « néolibéralisme » fluctue au fil des décennies, le terme étant tantôt employé pour désigner un ultra-libéralisme sans bornes, ou au contraire une version « modérée » ou « raisonnable » du libéralisme traditionnel. Ainsi, en 1963, et jusqu’à la fin des années 70, John Kenneth Galbraith, un keynésien de gauche, pouvait être présenté comme un « néolibéral » en France, c’est à dire ainsi :
« Être libéral à la manière de Galbraith, ce n’est pas accepter béatement le mythe de la libre concurrence ou le « laisser-faire, laissez-passer » de l’administration Eisenhower, c’est oser reconnaître ces vérités qui ne sont probablement pas évidentes pour tous : même aux États-Unis, la planification s’impose ; un gouvernement digne de ce nom doit avoir le courage de bloquer à temps le prix de l’acier ou la hausse de la bourse ; un pays libre devrait accepter des impôts élevés » [3].
Curieuse définition qui ressemble fort peu à celle que l’on accepte aujourd’hui communément pour le « néolibéralisme » !
Le néolibéralisme n’existe-t-il pas pour autant ? On peut en douter : il existe pléthore de textes plus anciens et d’auteurs se réclamants d’un néolibéralisme. Ne s’agirait-il pas, sur un autre plan, que d’une querelle de mots ? Pas nécessairement : la distinction entre un « néolibéralisme » voir un « ultralibéralisme » prétendument extrême et un « libéralisme » modéré permet de dédouaner ce dernier. Il suffirait alors de revenir à cette forme plus raisonnable pour retrouver une économie fonctionnelle… Dès lors, la moindre règlementation, la moindre intervention de l’État peut être présentée comme un pas dans la bonne direction, pour s’éloigner de ce « néo-libéralisme » ultra qui ressemble ainsi décrit fortement à un anarcho-capitalisme. Par conséquent, il peut être utile d’y voir plus clair : existe-t-il un néolibéralisme ? Les politiques contemporaines sont-elles néolibérales, c’est-à-dire une version différente et radicale du libéralisme, ou autre chose encore ?
Avant de commencer, soulignons les limites de notre approche : le libéralisme n’est pas qu’une théorie économique, pas plus qu’une théorie économique et une théorie politique que l’on pourrait séparer. Il forme un tout [4], fait d’une vision politique, d’une vision économique et même d’une vision morale [5] dont la dissociation risque toujours de faire perdre de vue certains aspects lorsque l’on étudie [6].
I) Les années 1930 et le Colloque Lippmann : l’émergence d’un néolibéralisme
Au cours du 19ème siècle et pour une part du 20ème, une conception radicale du libéralisme économique dominait : le laissez-faire, que ses adversaires désigneront ultérieurement comme le « libéralisme manchesterien ». La crise des années 30 le détrône de sa position. La catastrophe économique fait tenir le libéralisme pour responsable, et provoque son rejet par les élites politiques et les populations : les pays occidentaux se laissent séduire par le planisme, le socialisme, voir l’autoritarisme. Le libéralisme dans son ensemble, au-delà de sa seule dimension économique, paraît menacé. Face à cette débâcle, des penseurs libéraux cherchent à restaurer le crédit de leur idéologie, quitte à la rénover. L’époque est propice à la rénovation : dans ces années 30 prolifèrent toutes sortes de nouvelles théories politiques : néocapitalisme, néo-socialisme, néo-corporatisme… C’est ainsi que naît l’idée de construire un néo-libéralisme. Pour organiser cette réflexion, qui est jusque-là le fait d’auteurs épars, un libéral français, Louis Rougier [7], décide d’organiser un colloque qui deviendra fondateur, à l’occasion de la visite d’un auteur américain à Paris : le Colloque Walter Lippmann.
L’ambition réelle, plus que de présenter le dernier livre de Lippmann, est de débattre de cette refondation : sont invités en conséquence des libéraux de tous les horizons et de diverses opinions : intellectuels, patrons ou hauts fonctionnaires, de France, du Royaume-Uni ou d’Autriche ; qui pour l’essentiel deviendront des grands noms du libéralisme : Friedrich Hayek, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke, Raymond Aron…
II) Les néolibéraux, des réformateurs modérés et interventionnistes
Au cours du colloque, deux groupes se distinguent, sans être eux-mêmes parfaitement homogènes : « d’un côté, ceux pour qui le néolibéralisme est foncièrement différent, dans son esprit et son programme, du libéralisme traditionnel, et, de l’autre, le « vieux libéralisme » qu’incarnent les ténors de l’école autrichienne comme Friedrich Hayek et Ludwig Von Mises. » [8]
Dans ce premier groupe, on distingue deux principaux sous-groupes : les libéraux français, et les libéraux allemands. Les deux, malgré quelques nuances, revendiqueront la création d’un nouveau libéralisme et formeront deux écoles distinctes : le néolibéralisme français et l’ordolibéralisme allemand. Ils tiennent le libéralisme « dogmatique » du 19ème siècle, le « laissez-faire », pour responsable de la crise et de sa propre déchéance. Ils estiment qu’il est à la fois nécessaire de revenir aux premiers auteurs libéraux tout comme de les adapter.
Jacques Rueff résumait ainsi leurs différences :
« Pour les libéraux d’ancienne observance, la liberté est, pour l’homme, l’état de nature. « L’homme est né libre, et, partout, il est dans les fers », s’indignait Rousseau, il y a déjà deux siècles. Si l’on veut rendre à l’homme la liberté perdue, il faut ne rien faire, mais seulement défaire les entraves qui l’en ont privé.
Pour le néolibéral, au contraire, la liberté est le fruit, lentement obtenu et toujours menacé, d’une évolution institutionnelle, fondée sur des millénaires d’expériences douloureuses et d’interventions religieuses et morales, politiques et sociales. À l’opposé de Rousseau, il pense que la grande majorité des hommes est née dans les fers, dont le progrès des institutions peut seul la sortir et ne l’a encore que très partiellement sortie.
Libéraux et néolibéraux ont une foi égale dans les bienfaits de la liberté. Mais les premiers l’attendent d’une génération spontanée, qu’il faut seulement ne pas compromettre, alors que les seconds veulent la faire éclore, croître et se développer, en la rendant acceptable et en écartant d’elle les entreprises qui tendent constamment à l’annihiler » [9]
Les néolibéraux (qui désignent ici les deux courants rénovateurs, français et allemands), prenant acte de la crise de 1929, reviennent sur certains fondamentaux du libéralisme économique. En premier lieu, le caractère naturel de la liberté et du marché : les deux ne sont pas spontanés, mais issus des sociétés humaines. Laissés à eux-mêmes, comme au temps du laissez-faire, leurs rouages se grippent – les ordolibéraux, en particulier, y voient la source de l’émergence de concentrations privées oligo- ou monopolistiques, très présentes en Allemagne. Pour ces néolibéraux, toujours, c’est le marché libre qui est à même d’assurer l’allocation optimum des richesses, mais il ne se suffit pas à lui-même : pour qu’il reste libre et efficace, ou même simplement fonctionnel, il faut une intervention de l’État, qui fixe un cadre juridique dans lequel le marché peut prendre place, et qui sache briser les concentrations. [10] En somme, l’État intervient essentiellement pour fluidifier le fonctionnement du marché – un comportement que Louis Rougier, et d’autres après lui, comparent à un code de la route. [11] Ce modèle néolibéral là apparaît donc déjà passablement plus modéré que le libéralisme contemporain d’un Salin ou d’un Rothbard. Mais il ne s’arrête pas là : alors que dans l’esprit des premiers libéraux, tel Adam Smith, l’État était légitimé pour un interventionnisme minimum face à des situations que le marché ne pouvait gérer [12], les néolibéraux des années 30 et 40 peuvent défendre des services publics d’État, la nationalisation de monopoles économiques naturels [13], voir même des services sociaux [14] ou, lorsque cela est requis, la restriction de la liberté économique ! [15] Leur influence ne fut pas mince : ainsi, ce sont eux qui mettront en place l’économie sociale de marché en Allemagne après la Seconde Guerre Mondiale, qui, toute libérale qu’elle fut, n’en était pas moins dénuée de services sociaux. Jacques Rueff fut un des principaux conseillers économiques du Général De Gaulle. [16] Plus proche de nous, la construction européenne repose sur ces deux écoles idéologiques, essentiellement l’ordo-libéralisme allemand, le néolibéralisme français ne s’étant jamais autant structuré que son cousin germanique.
III) Les paléo-libéraux et libéraux classiques : halte à l’État !
Mais à côté de ce néolibéralisme réformiste, interventionniste et social, s’en tient un autre. Ces « nostalgiques du laissez-faire » [17] voient d’un mauvais œil les penchants interventionnistes des néolibéraux, qu’ils décriront quelques années plus tard comme aussi potentiellement totalitaires que l’État providence ou le collectivisme [18]. Ceux-là, en retour, ne les apprécient guère non plus : des différents noms d’oiseaux (« pré-keynésiens ») que les uns et les autres se lancent lors du colloque, le grand représentant d’alors de l’école autrichienne, Ludwig Von Mises, finira par en retenir un, celui de « paléo-libéral », pour s’autodésigner. Si, dans un premier temps, ces libéraux-là se plient à l’air du temps et fustigent le « libéralisme vulgaire » qui les a précédés, ils ne sont pas pour autant en faveur d’un renouveau du libéralisme. En vérité, ce n’est à leurs yeux pas la trop grande liberté du marché, mais la trop grande intervention de l’État, qui mène à la crise économique. [19]Rapidement, ils s’orientèrent vers un autre chemin de rénovation du libéralisme : la redécouverte de leurs prédécesseurs les plus radicaux, tels que Bastiat ou Hume d’abord [20], et plus généralement les libéraux du 19ème siècle ensuite. [21] Regroupés dans « l’école autrichienne », autour d’Hayek et de Von Mises, et se ralliant ensuite « l’école de Chicago », représentée par Milton Friedman, ces libéraux se refusent aux concessions : haro sur l’État, sur la dépense publique, sur les prestations sociales. Friedman et Hayek tolèrent bien un « impôt négatif », mais il n’a vocation qu’à être temporaire, le temps de remettre l’économie socialisée sur les rails du libre-marché. Contrairement à leurs collègues néolibéraux, ils n’ont donc pas l’intention de faire intervenir l’État, mais celle de le « ramener à de justes proportions » [22]. Et contrairement à eux, ils refusent et dénoncent même l’étiquette de « néolibéralisme », se présentant personnellement comme des défenseurs du « classical liberalism » par opposition au « liberals » que sont les démocrates américains. Leur point de vue n’a en effet pas grand-chose de « néo » : même s’ils peuvent tenir compte des réflexions récentes, d’auteurs nouveaux et des apports de l’économie néo-classique, tout cela ne constitue pas à leurs yeux une rupture avec le libéralisme historique. Les qualifier de néolibéraux peut alors – à juste titre – être considéré comme abusif, tout comme il l’est d’en faire des « ultralibéraux » ou quelque nouvelle version extrémiste d’une idéologie normalement modérée. Le « libéralisme classique » d’Hayek, de Mises ou de Friedman n’est – et ils ne revendiquent pas être autre chose – qu’une réactualisation du libéralisme du 19ème siècle. Le néolibéralisme en est en revanche une refondation, et justifie, défend et réclame son appellation.
L’influence de ces deux idéologies fut significative. Le néolibéralisme imprima sa marque sur les politiques occidentales dès peu après sa fondation – la politique d’Edouard Daladier en France avant-guerre, de Ludwig Erhard en Allemagne après-guerre, de Valéry Giscard d’Estaing à partir de 1976, de la construction européenne… Si bien que nos systèmes politiques et sociaux reposent en partie sur des réformes néolibérales. Le « libéralisme classique » ne resta pas inactif non plus [23] : il se réorganisa, notamment au sein de la Société du Mont-Pèlerin, puis gagna en influence au sein du personnel politique et économique – par exemple la haute-administration française [24], avant de s’imposer par rapport au néolibéralisme [25].
Conclusion
Le néolibéralisme a bel et bien existé. Il est aujourd’hui minoritaire, voir, si n’était sa variante allemande, inexistant. C’est le « libéralisme classique » qui a triomphé et pris sa place, inspiré les réformes politiques des années 80 et fondé le consensus de Washington qui a mené à la crise de 2008. Le premier était une variante modérée du libéralisme, né dans les années 1930, favorable à des règlementations et des mesures sociales. Le second est difficilement qualifiable d’ « ultra », et moins encore de « néo » : il nous vient tout droit du 19ème siècle.
Il est alors compliqué de considérer le système économique en vigueur aujourd’hui comme une perversion du libéralisme qui aurait prévalu jusqu’aux années 80. On peut, bien sûr, avoir d’autres approches : par exemple, estimer que le libéralisme du 19ème siècle était déjà une version exagérée et ultra du libéralisme « originel » (ce qui fut le propos des néolibéraux), ou que le libéralisme contemporain contient une dimension nouvelle, puisqu’il serait à la fois libéral et libertaire (c’est le propos d’entre autres Jean-Claude Michéa et Michel Clouscard). Mais en tous les cas, l’étiquette de « néolibéralisme » semble inadaptée pour caractériser les politiques menées depuis 30 ans. Plus : il est peu crédible de dénoncer les mesures qui ont menés à la crise de 2008 comme une simple dérive d’un libéralisme classique raisonnable et vertueux qui aurait eu court dans les trois décennies précédentes.
Annexes : Bibliographie
AUDIER Serge, Néolibéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, 2012, 630p.
BILGER François, « La pensée néolibérale française et l’ordolibéralisme allemand » in Patricia Commun (dir.), Contributions du Colloque du 8 et 9 décembre 2000, L’ordolibéralisme allemand. Aux sources de l’économie sociale de marché, Travaux et documents du CIRAC, 2003
BILGER François, L’école de Fribourg, l’ordolibéralisme et l’économie sociale de marché, 2005, Texte en ligne : http://www.blogbilger.com/esm/ecoledefribourg.pdf
BILGER François et PALUSSIERE M., Les doctrines économiques actuelles : le néolibéralisme, 1969, Texte en ligne : http://www.blogbilger.com/esm/leneoliberalisme2.pdf
BONELLI Laurent et PELLETIER Willy (dir)., L’État démantelé, Enquête sur une révolution silencieuse, Paris, La découverte, 2010, 324p.
BURGI Noëlle, « La construction de l’État social minimal en Europe », Politique européenne, 2009/1, n°27, pp. 201-232
CABANNES Michel, La trajectoire néolibérale. Histoire d’un dérèglement sans fin, Paris, Le Bord de l’eau, 2013, 179p.
DARDOT Pierre et LAVAL Christian, « La nature du néolibéralisme : un enjeu théorique et politique pour la gauche », Mouvements, 2007/2 n° 50, p. 108-117.
DENORD François, « Aux origines du néo-libéralisme en France, Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938 »,Le Mouvement Social, 2001/2 no 195, p. 9-34.
DENORD François, Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, Demopolis, 2007, 380p.
DENORD François, « Néolibéralisme et « économie sociale de marché » : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », Histoire, économie & société, 2008/1 27ème année, pp. 23-33
DENORD François, « Le prophète, le pèlerin et le missionnaire », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 145, décembre 2002, La circulation internationale des idées, pp. 9-20
JOBERT Bruno (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe. Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris, L’Harmattan, 1994, 328 p.
JOBERT Bruno, « La fin de l’État tutélaire », Cahiers de recherche sociologique, n°24, 1995, pp. 107-126.
MERRIEN François-Xavier, « La Nouvelle gestion publique, un concept mythique », Lien social et Politiques, n°41, 1999, pp. 95-103
MICHEA Jean-Claude, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale. Paris, Flammarion, 2010, 205p.
Deux mots sur la bibliographie
Un ouvrage se révéla crucial au cours de cette recherche : celui de Serge Audier, Néolibéralisme(s), une archéologie intellectuelle. Il ne se contente pas de fourmiller de détails sur son sujet d’études, mais reprend aussi, de façon critique, les autres études du libéralisme contemporain : le courant bourdieusien (François Denord, Serge Halimi…), le courant foucaldien (Pierre Dardot, Christian Laval…), le courant « anti-68 » (Jean-Claude Michéa, Michel Clouscard, Régis Debray…). Il contient toutefois deux limites : la première, c’est qu’il s’agit en partie d’un ouvrage militant, de la part d’un « libéral de gauche ». La critique, initialement constructive lorsqu’elle se trouve dans l’introduction, dégénère rapidement en une tentation d’enfoncer ses adversaires, auxquels il n’avoue qu’à demi-mot un intérêt. Régulièrement, les mêmes textes et les mêmes auteurs sont rappelés à leurs fautes, d’une façon fort peu scientifique. A propos des mêmes erreurs. D’un bout à l’autre du livre. Passé la 500ème page, l’acharnement de l’auteur à marteler les mêmes attaques se fait pénible ou comique, d’autant que l’agressivité dont il fait preuve est loin d’être toujours justifiée, puisque certaines de ses propres critiques sont tout autant contestables. L’autre faiblesse, plus gênante, du livre, est qu’il ne quitte jamais la perspective du détail : il s’intéresse à chaque auteur libéral, liste leurs propres positions et soutient ces affirmations avec force références (parfois jusqu’au comique, lorsqu’il défend que « X était ami avec Y, ce qui prouve bien qu’il était modéré ! ») ; et ne donne donc jamais de vision d’ensemble. Si l’on sait ce qui sépare chaque auteur, il devient difficile de savoir ce qui les rassemble, ni même ce qui fonde chaque courant. Cette approche à toutefois l’intérêt de déconstruire l’image d’un « néolibéralisme » unifié et cohérent entre ses différents penseurs depuis sa fondation.
Références et notes de bas de page
[1] http://raphp.fr/blog/?p=34 , « Le tournant néo-libéral en France »
[2] SALIN Pascal, « Le néolibéralisme ça n’existe pas ! », Le Figaro, 6 février 2002
[3]Quatrième de couverture de J.K. Galbraith, L’Heure des libéraux, trad. J-L. Crémieux-Brilhac, Paris, Calmann-Lévy, 1963
[4] C’est le propos de Jean-Claude Michéa dans L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale. Paris, Flammarion, 2010, 205p.
[5]Dans la première version de son « Statement of Aims », les fondateurs libéraux de la Société du Mont Pèlerin écrivaient ainsi : « Any free society presupposes, in particular, a widely accepted moral code. The principles of this moral code should govern collective no less than private action», Draft Statement of Aims, Société du Mont Pèlerin, 7 avril 1947.
[6] « Le libéralisme c’est d’abord une morale individuelle, ensuite une philosophie de la vie en société dérivée de cette morale, enfin seulement, une doctrine économique qui se déduit logiquement de cette morale et de cette philosophie » Jacques de Guenin, Savez-vous vraiment ce qu’est le libéralisme ?, 2002
[7]Libéral « rénovateur », Louis Rougier disposait d’une certaine influence en France avant-guerre. Ses accointances avec le régime de Vichy lui feront perdre ce prestige après la Libération, et il sombrera dans un relatif oubli. Son rôle n’en demeure pas moins central dans la formation du néolibéralisme.
[8] DENORD François, « Les rénovateurs du libéralisme » in BONELLI Laurent et PELLETIER Willy (dir.), L’État démantelé. Enquête sur une révolution silencieuse, Paris, La Découverte, 2010, p. 36
[9] RUEFF Jacques, Combats pour l’ordre financier : Mémoires et documents pour servir à l’histoire du dernier demi-siècle, Paris, Plon, 1972, p. 29.
[10] « Entre ne rien faire et administrer tout, l’État libéral prend le parti de tout surveiller en disant le droit, en faisant respecter par tous la loi égale pour tous. Il ne prétend pas se substituer au jeu régulateur de l’équilibre économique, mais il vise à dégripper, au nom de l’intérêt collectif, les facteurs naturels de l’équilibre. […] En résumé, le libéralisme constructeur admet l’ingérence juridique de l’État pour protéger la libre compétition qui seule permet de sélectionner les valeurs […]. » Louis Rougier, cité par STEINER Yves in « Louis Rougier et la Mont Pèlerin Society : une contribution en demi-teinte », Cahiers d’épistémologie du département de philosophie, Université du Québec, n°2005-10, p. 38-39.
[11] « Être [néo-]libéral, ce n’est pas comme le manchestérien, laisser les voitures circuler dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d’où résulteraient des encombrements et des accidents incessants ; ce n’est pas, comme le planiste, fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire ; c’est imposer un Code de la route, tout en admettant qu’il n’est pas forcément le même au temps des transports accéléré qu’au temps des diligences. » ROUGIER Louis in « Travaux du Centre international d’études pour la rénovation du libéralisme », Le Colloque Lippmann, Paris, Librairie de Médicis, 1939, page 16.
[12]« Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois devoirs à remplir ; trois devoirs, à la vérité, d’une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d’une intelligence ordinaire. (…) –Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses. » SMITH Adam, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre 1, chapitre 9, 1776, traduit par G. Garnier, revue par A. Blanqui (1881)
[13] « Dans les années 1940, Röpke va très loin dans la reconnaissance de la légitimité d’une intervention de l’État en matière économique, pour les cas où elle peut être perçue comme légitime. Si, pour les services publics – chemins de fer, postes, tramways, services de l’eau, du gaz et de l’électricité, radio, etc. , personne ne niera a priori la nécessité, selon lui, que ces entreprises soient remises à l’État et aux associations publiques, une question plus délicate est celle de savoir si ce principe ne devrait pas s’appliquer aussi à tous les « monopoles naturels » et, au besoin, à la production de fer et d’acier, qui peut faire l’objet de « concentrations néfastes » AUDIER Serge, Néolibéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, 2012, page 441.
[14] « L’ « Agenda du libéralisme » de Walter Lippmann [adopté à l’issue du Colloque Lippmann] permet aussi de préciser certains des postulats du néo-libéralisme : le recours au mécanisme des prix comme principe organisateur de l’activité économique ; la responsabilité juridique de l’État pour instaurer un cadre marchand ; la nécessité du libéralisme politique pour établir les lois ; la possibilité pour un régime libéral de poursuivre des fins sociales et de prélever dans ce but une partie de la richesse nationale par l’impôt. », DENORD François, Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, Demopolis, 2007, page 122.
[15]« Pour [les ordolibéraux], la liberté n’est pas le bien suprême. Avec Kant, ils prônent la liberté dans le respect de la loi morale, autrement dit la seule liberté de bien faire et non la liberté absolue. Aussi n’hésitent-ils pas, quand le bon fonctionnement de l’économie de marché le requiert, à restreindre de diverses manières la liberté économique dans l’intérêt général. » BILGER François, « La pensée néolibérale française et l’ordolibéralisme allemand », in Patricia Commun (dir.), Contributions du Colloque du 8 et 9 décembre 2000, L’ordolibéralisme allemand. Aux sources de l’Economie sociale de marché, Travaux et documents du CIRAC, 2003, page 8.
[16] Il inspira fortement le Plan Pinay-Rueff de 1958 ainsi que le Plan Rueff-Armand de 1959.
[17] DENORD François, « Néo-libéralisme et « économie sociale de marché » : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », Histoire, économie & société, 2008/1 27e année, page 26
[18]« Ce que l’on sait, c’est qu’une économie sociale de marché n’est pas une économie de marché, qu’un État social de droit n’est pas un État de droit, qu’une conscience sociale n’est pas une conscience, que la justice sociale n’est pas la justice, et je crains aussi qu’une démocratie sociale ne soit pas la démocratie. », HAYEK Friedrich, intervention à Fribourg du 6 février 1979, cité par PIPER Nikolaus., « Die unheimliche Revolution », Die Zeit, 5 septembre, 1997
[19] Ainsi, disait Ludwig Von Mises, « Ce n’est pas le libre jeu des forces économiques, mais la politique antilibérale des gouvernements, qui a créé les conditions favorables à l’établissement des monopoles » cité dans : CIRL, Compte rendu des séances du Colloque Walter Lippmann, Paris, Éditions de Médicis, 1939, page 37
[20] « Hayek procède, au-delà de quelques concessions critiques, à une réhabilitation créative du libéralisme classique. » AUDIER Serge, op. cit., page 220
[21] « Alors que l’école ordo-libérale s’était construite contre les impasses du « laisser-faire » manchestérien, Friedman n’hésite pas à s’en réclamer, au nom d’une certaine « radicalité » libérale. » AUDIER Serge, op. cit., page 459
[22] Milton Friedman, « Tax cuts=smaller government », The Wall Street Journal Europe, 20 janvier 2003. Il estime ces “justes proportions” entre 10 et 15% du PIB.
[23] Voir sur ce même site : http://raphp.fr/blog/?p=34
[24]« Désireux d’acquérir une visibilité internationale dans une discipline scientifique très dominée par les États-Unis, rêvant sans doute d’un Nobel pour leur leader, les fonctionnaires-économistes de la mouvance d’E. Malinvaud, directeur de la DP puis de l’INSEE vont impulser une reconversion en profondeur de la formation à l’ENSAE et des études et recherches conduites par les institutions publiques d’économie. (…) D’où cette mobilisation par les économistes d’État français, en dépit de leur parfum d’ésotérisme, des thèmes de la « nouvelle économie » néo-libérale qui faisait déjà depuis plusieurs années les choux gras des étudiants de Sciences Po. », JOBERT Bruno et THERET Bruno, « France, la consécration républicaine du néo-libéralisme », in JOBERT Bruno (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe, Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris, L’Harmattan, page 26.
[25] « La convergence tient au fait qu’aussi bien en France qu’en Allemagne, les penseurs que nous avons évoqués ont beaucoup perdu de leur influence au profit de nouveaux maîtres, à savoir d’une part ceux de la vieille école autrichienne (L. von Mises et F. von Hayek) et d’autre part ceux des nouvelles écoles américaines (Milton Friedman, James M. Buchanan …). (…) On observe indiscutablement dans les deux pays une évolution parallèle d’un libéralisme à forte organisation économique et à orientation sociale marquée vers un libéralisme plus flexible et plus individualiste, voire même un ultra-libéralisme, et le passage commun d’une conception d’économie sociale de marché à une conception d’économie capitaliste de marché. Il y a une sorte d’inversion de l’évolution du XXè siècle, un retour en arrière vers le XIXè siècle, qui s’observe d’ailleurs également dans les réformes et les politiques économiques pratiquées. On peut dire, je crois, que, sur le plan des idées libérales, le XXIè siècle sera sûrement plus proche du XIXè que du XXè siècle et ceci tant en Allemagne qu’en France. » BILGER François, op cit., page 9.
Pour discuter de l’article, c’est ici : http://www.raphp.fr/fofo/viewtopic.php?f=2&t=2377



 ). A l’inverse, la consommation de ressources diminue substantiellement, ce qui devrait nous éviter d’avoir à subir une vraie pénurie qui arrêterait net nos industries.
). A l’inverse, la consommation de ressources diminue substantiellement, ce qui devrait nous éviter d’avoir à subir une vraie pénurie qui arrêterait net nos industries.




















 Le temps passera donc bien plus vite qu’une fois la guerre entamée.
Le temps passera donc bien plus vite qu’une fois la guerre entamée.